L’historien Nicolas Lebourg est chercheur au Centre d’études politiques de l’Europe latine (Cepel) à l’université de Montpellier, il est spécialiste de l’extrême droite. Et du camp de Rivesaltes, surnommé le Drancy du Sud de la France, qui fête ses dix ans. Et où ont vécu dans des conditions très difficiles 70 000 personnes.
Tables-rondes, témoignages… Ce samedi 18 octobre, le Mémorial du camp de Rivesaltes organise une journée spéciale dédiée aux 10 ans de ce lieu d’histoire et de mémoires, dans un contexte de refonte de son parcours scénographique. Seront présents Agnès Langevine, vice-présidente de la Région Occitanie, Hermeline Malherbe, présidente du Département des Pyrénées-Orientales.
“En octobre 2015, le Mémorial du camp de Rivesaltes ouvrait ses portes au terme d’un long travail de préfiguration. Dix ans plus tard, la Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée et le Département des Pyrénées-Orientales, collectivités fondatrices de ce lieu de mémoire unique, ont décidé de procéder à un travail de refonte scénographique de son exposition permanente, bénéficiant d’un soutien de l’Union européenne via le Feder.” La réouverture de la salle d’exposition aura lieu au printemps 2026.
Faire dialoguer les mémoires, les savoirs et l’art
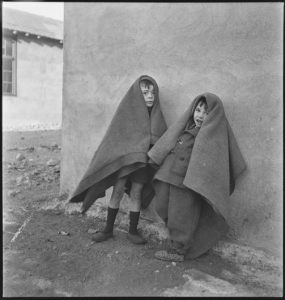
Au-delà de la célébration d’une décennie d’engagement et de transmission des
mémoires des populations internées ou reléguées au camp de Rivesaltes au cours
de la seconde moitié du XXe siècle, “cette journée anniversaire vise à faire dialoguer
les mémoires, les savoirs et l’art, en croisant les voix de témoins, de chercheurs, de
pédagogues et d’artistes – un format fidèle à l’approche scientifique et sensible qui
constitue l’ADN du lieu depuis sa préfiguration », explique-t-on au Mémorial.
Elle a également pour objectif d’affirmer le rayonnement scientifique du Mémorial aux plans national et international comme lieu de recherche, d’archives, de coopération muséale et de réflexion historique. Enfin, cette journée sera l’occasion de donner à voir la dynamique collective qui a façonné le Mémorial : collectivités fondatrices, chercheurs, associations, partenaires, acteurs pédagogiques, artistes, et témoins.
On a longtemps dit que le camp de Rivesaltes était un tabou ; aujourd’hui, on fête les dix ans de son Mémorial : comment est-on passé du silence à l’institution ?
Nicolas Lebourg : La mémoire était effectivement vague autour des phénomènes connus (l’internement des Juifs ou des Républicains espagnols, le rassemblement des Harkis) et nulle sur certains phénomènes complètement ignorés (par exemple, la prison des indépendantistes algériens en 1962 ou l’installation d’anciens militaires guinéens qui sont deux phénomènes que j’ai découverts lors de mes recherches).
Après des décennies de déni, il y a eu un premier geste en 1993 : l’installation d’une stèle par Serge Klarsfeld en l’honneur des Juifs internés et transférés vers Drancy (Seine-Saint-Denis). Mais ça n’a aucun impact sur le territoire : personne n’en parle et ça n’empêche même pas le projet de noyer le camp sous une zone d’épandage des boues quelques années plus tard. C’est la révélation par L’Indépendant, quotidien local, en 1997, que des archives du camp relatives à la déportation des Juifs ont été retrouvées à la déchetterie qui provoque un électrochoc. Une pétition citoyenne réclame un Mémorial. Quand le socialiste Christian Bourquin gagne les élections l’année suivante, il lance le projet.
Combien de minorités invisibilisées sont-elles passées par Rivesaltes ?

Nicolas Lebourg : Dans la partie militaire du camp on a très longtemps invisibilisé le fait que c’étaient des troupes coloniales, des soldats sénégalais, malgaches… Pour les Espagnols, la mémoire dans toute l’Occitanie des camps de 1939 a été réactivée à la fin des années 1990. Il reste aujourd’hui un certain flou sur les Groupes de travailleurs étrangers, les GTE, liés au camp de Rivesaltes, des unités de travail où sont versés les Républicains espagnols encadrés par l’armée française. Mais l’historien Grégory Tuban prépare un livre à ce sujet. La mémoire des Juifs n’a pas toujours été là : en 1968 le préfet du département écrivait que les GTE d’Espagnols “ont constitué le peuplement presque exclusif du camp militaire de Rivesaltes”. Sur la mémoire des persécutions antisémites il faut justement absolument lire le dernier livre de Laurent Joly, le président du conseil scientifique du Mémorial.
Pour les nomades, c’était très flou jusqu’aux travaux de l’historien Alexandre Doulut qui a démontré que c’est le camp de Vichy qui en a concentré le plus. Il est d’ailleurs significatif que dans les stèles commémoratives celle qui leur est relative ait été installée en dernier, en 2009. Je le dis en dernier mais c’est par rapport aux populations civiles internées.
Serge Klarsfeld a aussi fait installer en 2018 une stèle en mémoire aux prisonniers de guerre allemands rassemblés là après-guerre. Ce ne sont pas des civils internés arbitrairement eux mais des membres de la Wehrmacht et de la Waffen-SS soumis aux règles de la guerre, ça crée une confusion regrettable. C’est comme un oignon Rivesaltes : le dernier avatar du camp ça a été un centre de rétention administrative sur le site, fermé en 2007.
Ce qui est très singulier, c’est que donc tout ce travail historique ne se fait pas avant mais après le retour en mémoires et la décision de créer le Mémorial”
Comment les historiens ont-ils travaillé ?

Nicolas Lebourg : La première à travailler sur le camp a été Anne Boitel. Ce n’était pas pour le projet de Mémorial, mais le scandale avait attiré son attention de la jeune étudiante et elle a fait du camp son sujet de master, dédié aux années 1941-1942, qui est devenu un livre.
Le département a embauché d’abord des post-doctorants. Ça a été mon cas en 2006, en étant en charge de toutes les périodes. Abderhamen Moumen est arrivé en 2007 et a fait un travail formidable sur les harkis. Il y a eu ensuite Alexandre Doulut, qui a entrepris la démarche colossale de rassembler toutes les informations sur les internés des années 1941-1942, ce qui a entre autres permis de démontrer que c’est le cas de Vichy qui a concentré le plus de “nomades “. Ce qui est très singulier, c’est que donc tout ce travail historique ne se fait pas avant mais après le retour en mémoires et la décision de créer le Mémorial. Même le concours d’architecture se fait avant la recherche historique que l’on est ensuite censés vulgariser à l’intérieur !
Le bâtiment a valu à Rudy Riccotti, architecte du Mucem (Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée, à Marseille), de recevoir l’équerre d’argent : quel regard portez-vous sur ce monolithe ?
Nicolas Lebourg : En 2005, le département lance l’appel à projets pour le bâtiment. 46 propositions lui sont adressés. Le projet gagnant se démarque totalement de certains qui se veulent grandioses, gigantesques. C’est un monolithe de béton de 230 mètres de long sur 20 de large, enterré au ras du sol au départ, puis s’élevant doucement pour atteindre le faîte des baraques. Le bâtiment compte de gigantesques couloirs et est aveugle, seulement éclairé par les patios, faisant ainsi écho aux témoignages des internés narrant leur déambulation dans le camp avec le ciel pour seule échappatoire. Les baraques autour ne sont pas impactées, le MCR étant enfoui dans l’axe de l’ancienne place de rassemblement.
Des mémoires désarmées, c’est un vrai plus. D’autant qu’à l’inverse on peut les investir et les retourner”
La polémique créée par le RN récemment est-elle une tentative de réécrire l’histoire ? Pourquoi ?

Nicolas Lebourg : Il y a trois niveaux de réponse : local, national, global. A l’échelle locale : actuellement, on voit les conseillers municipaux perpignanais partager sur les réseaux sociaux des panneaux de soutien au candidat lepéniste à Rivesaltes.
Aux dernières législatives, le RN y a fait 49 % au premier tour : ça ouvre l’appétit pour les municipales. Par-delà, Rivesaltes fait partie de la communauté urbaine de Perpignan ; or, celle-ci n’est pas tenue par son maire Louis Aliot, vice-président du RN, mais par le maire d’un autre village. Mettons-nous à la place du RN : avoir la préfecture mais pas son agglo est rageant, et coller la pression tentant.
Nationalement, l’entretien des divisions, d’une politisation du ressentiment, est une chose importante pour pouvoir présenter son offre politique de régénération unitariste, ce qui est le fond culturel de l’offre politique lepéniste. Des mémoires désarmées, c’est un vrai plus. D’autant qu’à l’inverse on peut les investir et les retourner. Louis Aliot estime que son camp politique n’a aucune gêne à avoir quant aux mémoires. L’un des membres de ses équipes a d’ailleurs auto-édité un ouvrage en 2017 traitant des enfants de la Retirada et du sort des Républicains espagnols dans le camp nazi de Mauthausen. Le texte présente l’engagement au FN comme la continuité du combat antifasciste, et la préface de Louis Aliot loue l’assimilation et le patriotisme de ceux qui furent Espagnols et devinrent Français. C’est une mémoire de la guerre d’Espagne et de Vichy détachée de son antifascisme traditionnel, et dès lors légitimatrice pour une offre politique souvent confrontée aux mémoires du XXè siècle.
Enfin, il y a le contexte global. Il a le visage de Donald Trump. Le sociologue Gérald Bronner dit que nous sommes rentrés dans l’ère de la “post-réalité”. Je trouve la formule fort bien troussée pour comprendre comment des élus RN peuvent oser dire qu’il n’y a rien sur les Harkis au Mémorial quand des dizaines de milliers de visiteurs peuvent témoigner du contraire. Le réel est aboli.
Le ressentiment des uns contre une minorité, l’indifférence des autres à ce que l’on fait à cette minorité, c’est le moteur d’une tragédie toujours recommencée et qui à la fin balaye la dignité humaine”
Quelle leçon nous “donne” le camp de Rivesaltes ?

Nicolas Lebourg : Je ne suis pas convaincu qu’il y ait des leçons de l’histoire. Il faut être très modeste en la matière. Néanmoins, ce que nous raconte ce site c’est que les “indésirables“, comme on disait dans les années 1930 mais que j’ai réentendu récemment, sont repoussés à la périphérie, dans des conditions de vie plus précaires encore que celles des couches sociales les plus paupérisées – mais qui, elles, sont libres.
Sans que les situations ne soient en rien assimilables, il existe toutefois une permanence entre les usages du camp de Rivesaltes : la gestion coercitive des flux humains par un État bureaucratique dans une société qui se désintéresse des populations internées. S’il y a une leçon à retenir c’est que les bourreaux ont beaucoup moins d’importance pour exercer leur fonction que l’indifférence que nous avons. Le ressentiment des uns contre une minorité, l’indifférence des autres à ce que l’on fait à cette minorité, c’est le moteur d’une tragédie toujours recommencée et qui à la fin balaye la dignité humaine.
Propos recueillis par Olivier SCHLAMA
Programme de la journée
🕝 14h00 – Présentation du nouveau projet muséal
🕒 14h30 – Ouverture officielle
Accueil par Céline Sala-Pons, Directrice du Mémorial du camp de Rivesaltes.
Prise de parole d’Hermeline Malherbe, Présidente du Département des Pyrénées-
Orientales et vice-Présidente du Mémorial du camp de Rivesaltes. Prise de parole d’Agnès Langevine, représentant Carole Delga, Présidente de la région Occitanie Pyrénées-Méditerranée et Présidente du Mémorial du camp de Rivesaltes.
Prise de parole de Pierre Regnault de la Mothe, Préfet des Pyrénées-Orientales.
🕞 15h00 – ACTE I
Construire un lieu pour se souvenir : ce que Rivesaltes nous a appris !
Table ronde
